

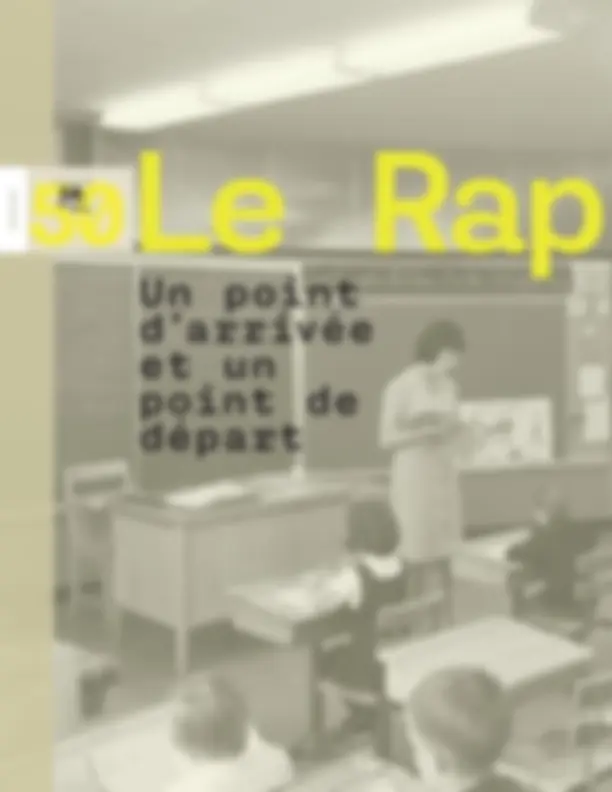
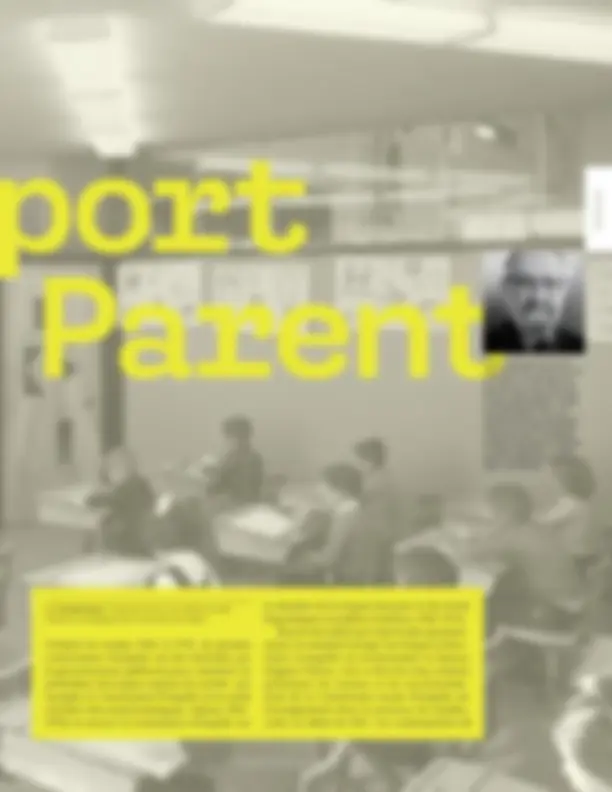




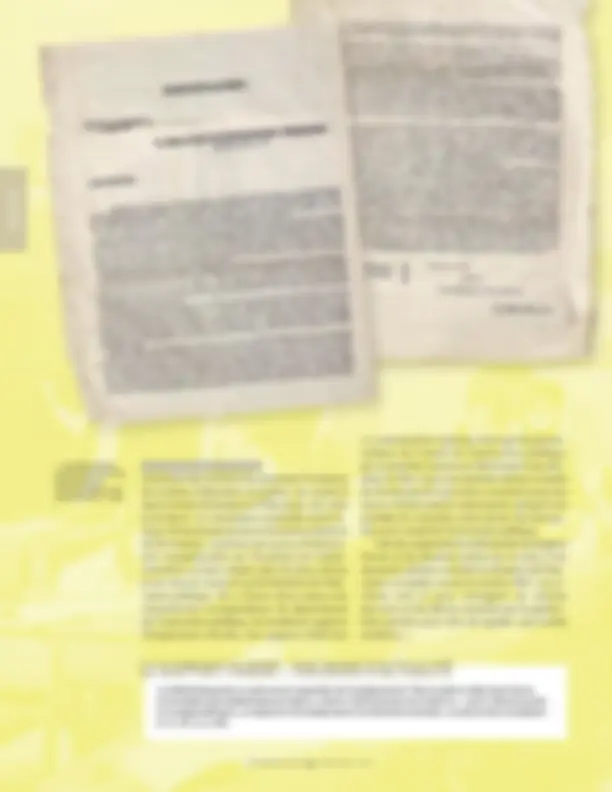






















Study with the several resources on Docsity

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity

Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
Rapport Parent (document). Law in Quebec (education)
Typology: Study notes
1 / 36

This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!


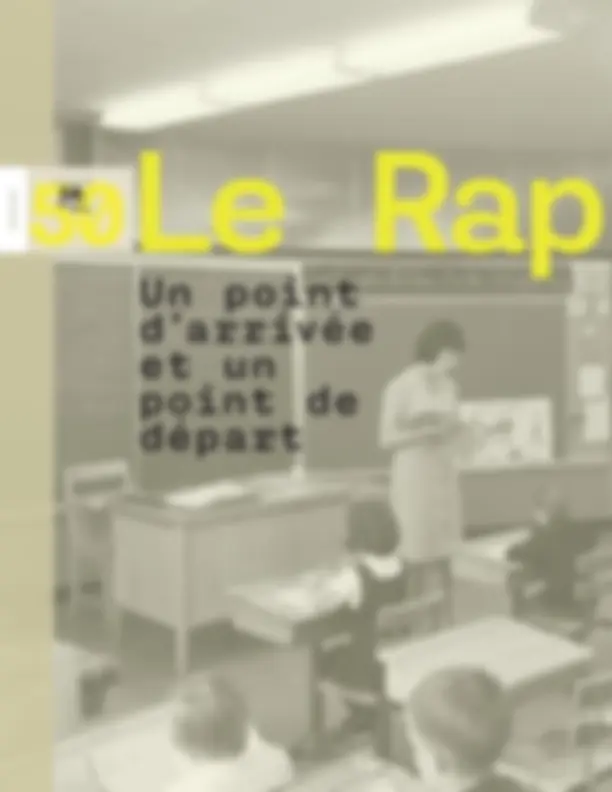
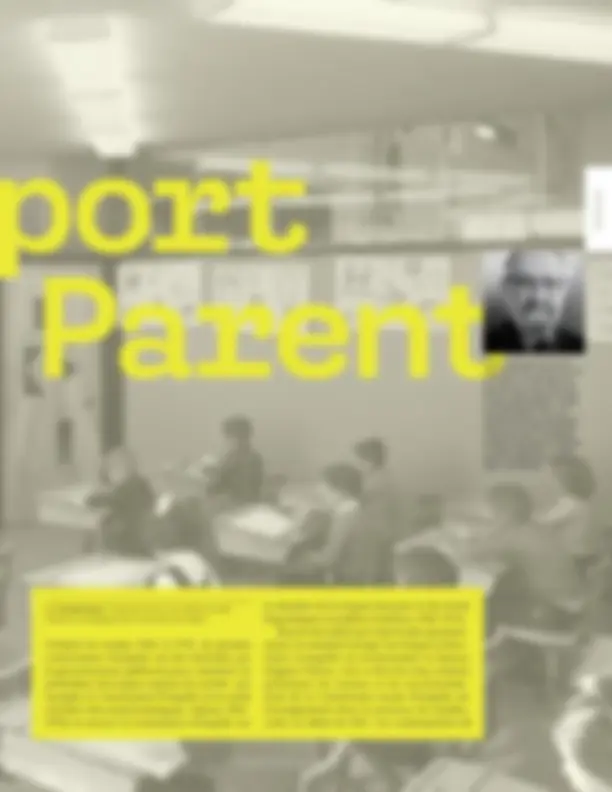




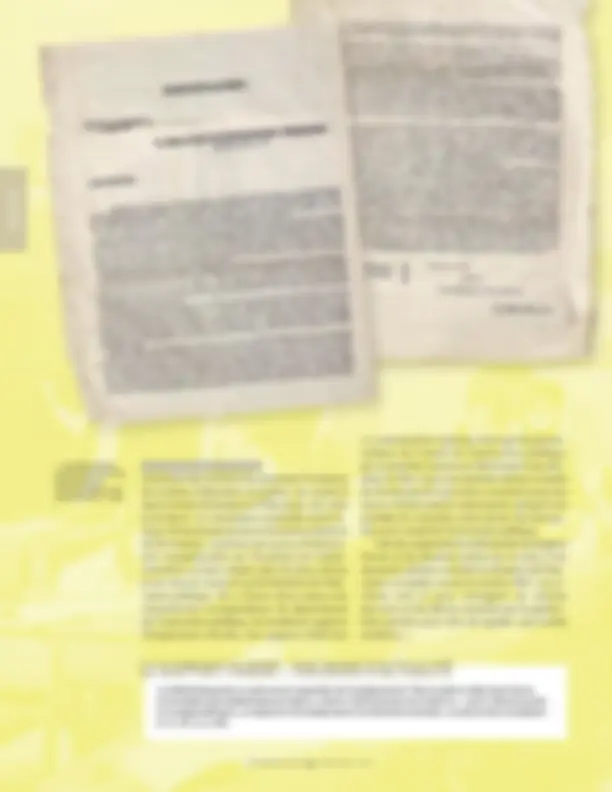




















H i v e r
2 0 1 4
H i v e r
2 0 1 4
En couverture : Couvent de Maniwaki, classe de 5 e^ année française, 1952. BAnQ Québec, fonds Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (E13, D1, P55). Photographe non identifié. Détail.
s o m m a i r e
c H r o n i Q u e s d e B i B l i o t H È Q u e e t a r c H i v e s n a t i o n a l e s d u Q u é B e c H I V E R 2 0 1 4 n ° 9 4
« L’éducation, l’éducation, l’éducation » d o s s i e r le rapport parent
et un point de départ
Les sources archivistiques du système d’éducation
Quatre points de vue contemporains sur l’éducation
l a v i e d e B a n Q
pour le dépôt légal et l’isBn
coulisses de l’émission Qui êtes-vous?
voir Suggestions de lecture, d’écoute et de visionnement
Retour sur un automne scientifique
Partie 3 : Un aperçu des collections le rapport parent :touJours d’actualité de microfilms Les encadrés placés aux pages 6, 8, 9, 13, 14 et 21 sont des extraits du Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, Québec, La Commission, 1963-1966, 3 t. en 5 vol. Ils ont été choisis par Michèle Lefebvre, bibliothécaire à la Collection nationale, Grande Bibliothèque, qui a aussi sélectionné les ouvrages de la page 9.
RÉDACTRICE EN CHEF sophie montreuil ADJOINTE À LA RÉDACTION isabelle Crevier DIRECTION ARTISTIQUE Jean Corbeil CONCEPTION GRAPHIQUE Jean-François Lejeune RÉVISION LINGUISTIQUE roxane Desjardins, Linda nantel et nicole raymond PRODUCTION suzanne Dugas PHOTOGRAPHIES atsa : p. 29 · Karine Dufour : p. 24 (Guy a. Lepage), 25 (Patrice L’Écuyer) · michel Gagné : p. 3 · Claude Lacasse : p. 18 (marie mc andrew) · Christine Lebel : p. 24 (marina orsini) · michel Legendre : p. 6, 12, 14, 27, 30, 36 · Pierre Perrault : p. 7 · Guillaume simoneau : p. 28 · nathalie st-Pierre : p. 18 (monique Brodeur, Paul Bélanger et marc st-Pierre), 19 (en haut, détail), 20 (en haut, détail), 21 (en haut, détail) · Émilie tournevache : p. 18 (Lucie sauvé) · uQam : p. 5 (Claude Corbo)
Cett e publication est réalisée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Nous tenons àremercier les artist es ainsi que les entreprises et organismes qui ont bien voulu nous permett re de reproduire leurs œuvres et leurs documents. La revue À rayons ouverts – Chroniques de Biblio- thèque et Archives nationales du Québec est publiée trois fois par année et dist ribuée gratuitement à toute personne qui en fait la demande. On peut se la procurer ou s’y abonner en s’adressant par écrit à : Bibliothèque et Archives nationales du Québec Direct ion des communications et des relations publiques 475, boulevard De Maisonneuve Est Montréal (Québec) H2L 5C ou par courriel à aro@banq.qc.ca. On peut consulter À rayons ouverts sur notre portail Internet à banq.qc.ca. Toute reproduct ion, même partielle, des illust rations ou des articles publiés dans ce numéro est st ricte- ment interdite sans l’autorisation écrite de BAnQ. Les demandes de reproduct ion ou de traduct ion doivent être acheminées à la rédact ion. NOTE SUR LES ILLUSTRATIONS À moins d’avis contraire, les illust rations fi gurant dans À rayons ouverts sont tirées de documents issus des collect ions de BAnQ. Les légendes des documents d’archives de l’inst itution comportent la mention du centre où ils sont conservés et du fonds dont ils font partie afi n de permett re de les retracer à l’aide de l’outil Pistard. Tous les autres documents de BAnQ présentés dans la revue peuvent être trouvés en consultant le catalogue Iris. Ces deux outils de recherche sont disp onibles à banq.qc.ca. Tous les efforts ont été faits par BAnQ pour retrouver les détenteurs de droits des documents reproduits dans ce numéro. Les personnes possédant d’autres renseignements à ce propos sont priées de communiquer avec la Direct ion des affaires juridiques de BAnQ. Ce document est imprimé sur du papier fabriqué au Québec contenant 50 % de fi bres recyclées post indust rielles, certifi é choix environnemental ainsi que FSC Mixte à partir d’énergie biogaz. © Bibliothèque et Archives nationales du Québec Dépôt légal : 1er^ trimest re 2014 ISSN 0835-
« L’éducation, l’éducation, l’éducation »
Les sources archivistiques du système d’éducation
r u B r i Q u e s
Avec Louis Vachon, président de la campagne de financement de la Fondation de BAnQ
sur les acquisitions patrimoniales
d o s s i e r
Un point
d’arrivée
et un
point de
départ
d o s s i e r
par Claude Corbo, chargé de mission aux affaires acadé- miques et stratégiques de l’Université du Québec
Pendant les années 1960 et 1970, de grandes commissions d’enquête ont été instituées par le gouvernement québécois pour examiner en profondeur des enjeux majeurs de société : par exemple, la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social (Castonguay-Nepveu, 1966-
la situation de la langue française et des droits linguistiques au Québec (Gendron, 1968-1973). Mais le document qui vient le plus spontané- ment à la mémoire lorsque l’on évoque la Révo- lution tranquille est certainement le fameux Rapport Parent, c’est-à-dire les cinq volumes présentant les travaux et les recommanda- tions de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, créée au début de 1961. Les contemporains
Docteur en philosophie et professeur à l’Université du Québec à Montréal dès 1969, Claude Corbo y a occupé plusieurs fonc- tions, dont celle de recteur (1986-1996 et 2008-2013). Auteur de plusieurs ouvrages et rapports gouvernementaux, il a notam- ment publiéRepenser l’école – Une anthologie des débats sur l’éducation au Québec de 1945 au rapport Parent (2000), L’éducation pour tous – Une anthologie du Rapport Parent (2002) etArt, éducation et société postindustrielle – Le rapport Rioux et l’enseignement des arts au Québec, 1966-1968 (2006).
d o s s i e r
s Jean-Paul Desbiens, Les insolences du Frère Untel, 11 e^ édition, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1960.
Toutes les carences de l’éducation québécoise étant
connues, celles-ci font l’objet d’intenses débats publics
tout au long des années 1950.
récurrent, il n’y a pas de système de sub- ventions gouvernementales statutaires, et les universités, surtout francophones, crient famine. Les conditions de travail du personnel enseignant sont médiocres. Et il y a chez les franco-catholiques une sérieuse sous-scolarisation dans tous les ordres d’en- seignement.
u n e d é c e n n i e d e d é B at s Toutes les carences de l’éducation québécoise étant connues, celles-ci font l’objet d’intenses débats publics tout au long des années 1950. Ces débats prennent des formes très diverses et abordent tous les enjeux relatifs à l’éducation. Par exemple, au terme de trois années de travaux, en 1956, la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitu- tionnels recommande la création d’une commission d’enquête sur l’éducation. La vaste Conférence provinciale sur l’éduca- tion demande en 1958 la refonte de toutes les lois scolaires et propose elle aussi la création d’une commission d’enquête sur l’éducation. Plusieurs leaders d’opinion et des publications comme les célèbres Insolences du Frère Untel (1960) sensibilisent la population aux carences de l’éducation québécoise et à l’urgence d’une réforme. Pas étonnant que le Parti Libéral du Québec, opposition offi- cielle depuis 1944, inscrive dans son programme électoral de 1960 l’engagement de créer une « commission royale d’enquête sur l’éducation », ce qu’il proposera par projet de loi dès janvier 1961.
d o s s i e r
un droit universel pour tout individu et une nécessité pour une société industrialisée et dé- mocratique. Cette éducation doit être rendue accessible, notamment par la gratuité de tous les ordres d’enseignement. Elle doit intégrer tous les univers de connaissances, par la polyvalence de la formation. Tous doivent passer par la même école publique élémentaire et secondaire. Le premier tome du Rapport recommande que le système soit soutenu, dirigé et coordonné par un ministre de l’éducation assisté par un Conseil supérieur de l’éducation. Le Rapport dé- finit aussi les structures nouvelles du système : un
l e p o i n t d e d é pa r t d ’ u n e r é F o r m e e n p r o F o n d e u r d e l’ é d u c at i o n Q u é B é c o i s e La Commission royale d’enquête sur l’enseigne- ment dans la province de Québec, dont les membres sont nommés le 21 avril 1961, est ainsi un point d’arrivée, mais surtout un point de départ. En fait, en répondant aux carences de l’éducation québécoise du milieu du siècle, le Rapport Parent proposait l’architecture et les grands contenus du système d’éducation québé- cois qui est encore en place aujourd’hui. Le document est porté par une nouvelle philosophie de l’éducation : celle-ci est à la fois
Dans une société de plus en plus industrialisée et technique, l’éducation est un élément essentiel du bien-être ; c’est dans la mesure où chacun pourra se développer pleinement, aussi bien sur le plan intellectuel et moral que sur le plan physique, qu’il sera ensuite capable de donner sa mesure dans la société, d’y mener une vie fructueuse pour lui-même et pour les autres. De nos jours, aucun enfant ne doit se voir refuser la possibilité de s’instruire et de développer pleinement ses dons et ses aptitudes ; cela s’applique aussi bien aux filles qu’aux garçons, autant aux pauvres qu’aux riches, aussi bien aux enfants handicapés qu’aux enfants sans problèmes particuliers. Il y va non seulement de l’intérêt de l’enfant lui-même et de son avenir, mais aussi de l’intérêt de la société (t. 3, vol. 2, p. 220).
r Neuf commissaires et trois membres du personnel de la commission Parent. De gauche à droite : John McIlhone, C. Wynne Dickson, Sœur Marie-Laurent de Rome (Ghislaine Roquet), Michel Giroux, David Munroe, Arthur Tremblay, M gr^ Alphonse-Marie Parent, Jeanne Lapointe, Gérard Filion, Guy Rocher, Paul Larocque et Louis-Philippe Audet, 1961. BAnQ Québec, fonds Ministère de la Culture et des Communications, série Office du film du Québec (E6, S7, SS1, P1966-61H). Photo : Neuville Bazin.
d o s s i e r
s Lettre de la Commission des écoles catholiques de Hull à Rémi Lavigne, 8 mai 1962. BAnQ Québec, fonds Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (E116).
de la coMMission parent par Jean Maurice Demers, archiviste, BAnQ Québec Les archives de la commission Parent sont riches de contributions provenant de tous les horizons du Québec. Rédigées en français ou en anglais, elles expriment les points de vue de francophones, d’anglophones, d’autochtones et de quelques communautés culturelles ; de chrétiens (catholiques, protestants et orthodoxes) et de juifs ; de personnes physiques, d’associations, de maisons d’enseignement, de syndicats et d’entreprises. L’ensemble de cette documentation dresse un portrait général du système d’éducation québécois au début des années 1960 et ouvre les perspectives d’avenir qu’on entrevoyait à l’époque. Le fonds Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (cote E116) est mis à la disposition du public à BAnQ Québec. Il compte 9,25 mètres linéaires de documents textuels produits ou reçus par la Commission, créés essentiellement entre 1961 et 1966. Le fonds contient principalement les documents suivants : les mémoires soumis à la Commission ; la documentation rassemblée par la Commission (y compris quelques documents administratifs, notamment sur des séances tenues à huis clos) ; la correspondance avec des experts et des représentants de « corps publics, [d’]associations et [de] collectivités » ; les transcriptions d’audiences publiques tenues dans huit villes du Québec et des dossiers d’entrevues conduites par la Commission ; la copie de quelques mémoires importants présentés au ministre de l’Éducation et de documents administratifs de la Commission (documents préparatoires, ordres du jour, procès-verbaux, etc.). Les archives de la commission Parent sont décrites plus précisément dans l’outil Pistard, à banq.qc.ca. Il est possible de faire des recherches au niveau des dossiers, et parfois au niveau des pièces.
de la coMMission parentde la coMMission parentde la coMMission parentde la coMMission parentde la coMMission parentde la coMMission parentde la coMMission parentde la coMMission parentde la coMMission parentde la coMMission parent
d’enseignement, de syndicats et d’entreprises. L’ensemble de cette documentation dresse un portrait général du système d’éducation
Le fonds Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (cote E116) est mis à la disposition du public
d o s s i e r
réformes qui donnent une impulsion nouvelle à l’éducation au Québec. Mais qu’en est-il du système qui était en place à l’aube de ces grands changements? On peut trouver quelques pistes de réponses dans les fonds d’archives conser- vés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), par exemple dans ceux des grandes institutions gouvernementales liées à l’éducation qui se sont succédé sur une période de 160 ans et qui ont préparé le terrain à la mise en œuvre des réformes implantées au courant des années 1960.
par François David, adjoint du conservateur et directeur géné- ral des archives, et Sonia Lachance, archiviste, BAnQ Québec
La scolarisation obligatoire, les écoles secon- daires, les cégeps et les programmes de prêts et bourses font partie de notre quotidien. Tous ceux qui sont nés après 1960 ont connu d’une manière ou d’une autre les bons et moins bons côtés du sys- tème d’éducation qui découle encore aujourd’hui en grande partie du modèle instauré il y a 50 ans. En effet, dès la création en 1964 du ministère de l’Éducation, s’amorce une succession de
v Couvent de Maniwaki, classe de 5 e^ année française,
Les sources archivistiques du système d’éducation
d o s s i e r
nistratives sont remises en place. Cette réorgani- sation confirme le rôle du Conseil de l’instruction publique, désormais formé de deux comités, l’un catholique et l’autre protestant, et du départe- ment de l’Instruction publique. Cette structure du système scolaire aura cours au Québec, presque sans modification, durant près d’un siècle. Ce n’est qu’en 1964 que ce sys- tème est remis en cause à la suite des travaux ayant mené à la publication du Rapport Parent. L’État crée alors le ministère de l’Éducation, né de la fusion du ministère de la Jeunesse et du département de l’Instruction publique. Dans la foulée, l’État procède à la création d’un conseil consultatif formé de deux comités – l’un catho- lique et l’autre protestant –, pâle successeur du défunt Conseil de l’instruction publique. C’est ainsi que le ministère de l’Éducation voit le jour, ancêtre du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec tel qu’on le connaît au- jourd’hui. Cet important changement de la structure du système d’éducation survenu dans les années 1960 s’inscrit dans un plan de réforme majeur de l’ensemble de l’appareil gouvernemental. Aucune activité de l’État n’échappe à ce brassage d’idées qui aboutira à des changements majeurs qui s’avéreront les véritables clés de voûte de la mo- dernisation de l’État.
r Portrait de Jean-Baptiste Meilleur, Surintendant de l’Instruction publique de 1842 à 1855, par J[oseph] Dynes,
En 1867, la Constitution canadienne
fait officiellement de l’éducation
une compétence provinciale.
La personnalité du maître est donc tout entière en cause dans l’enseignement et, plus que ses leçons, c’est sa qualité humaine, même si elle est souvent silencieuse, qui impressionnera vérita- blement les jeunes et enrichira leur propre qualité humaine. C’est là qu’est l’éducation : dans ce contact, dans ce dialogue implicite d’un jeune élève désireux de s’accomplir avec l’adulte éclairé, équilibré, épanoui et généreux (t. 3, vol. 2, p. 198).
d o s s i e r
l e s s o u r c e s a r c H i v i s t i Q u e s L’essentiel des archives documentant l’évolution du système d’éducation au Québec est conservé dans le fonds Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Ce volumineux ensemble archivis- tique, formé de plus de deux kilomètres linéaires de documents, constitue une source d’informa- tion exceptionnelle sur l’évolution de l’admi- nistration scolaire depuis plus de deux siècles et sur tous les citoyens ayant bénéficié de l’édu- cation publique. On y trouve entre autres une volumineuse correspondance du département de l’Instruction publique, de nombreux rapports d’inspecteurs d’écoles, des rapports d’élection
de commissaires scolaires ainsi que les procès- verbaux du Conseil de l’instruction publique, de sa première réunion en 1860 jusqu’à son abo- lition en 1964. Dans une moindre mesure, le fonds du Secrétariat de la province constitue aussi une source d’information intéressante puisqu’il est possible d’y consulter, entre autres, les nomina- tions du Conseil de l’instruction publique. Afin de comprendre la réelle portée du Rapport Parent et des décisions prises par la suite, il est nécessaire de bien connaître la situation de l’édu- cation au Québec avant les années 1960. Les ar- chives sont là pour témoigner du chemin parcouru et des efforts consentis par les généra- tions passées pour faire du Québec une société moderne.
r Jean-Baptiste Meilleur, Circulaire, province du Canada, partie est, Bureau de l’instruction publique, feuille volante, Montréal?, s. é.,1842?.
La bibliothèque est un instrument essentiel de l’enseignement. Reconnaître cette importance primordiale de la bibliothèque scolaire, c’est en même temps reconnaître […] qu’il y faut accorder un budget suffisant, un espace convenable dans l’architecture scolaire, un personnel compétent (t. 2, vol. 2, p. 312).
de commissaires scolaires ainsi que les procès-
d o s s i e r
r Maman Fonfon, 1958. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Claudine Vallerand (P897, S4, D5). Photo : André Le Coz.
par Marthe Léger, archiviste, avec la collaboration d’Hélène Fortier, archiviste-coordonnatrice, BAnQ Vieux-Montréal
Claudine Vallerand (1908-2001), née Claudine Simard, est surtout connue comme l’animatrice de l’émission de télévision Maman Fonfon, présentée à Radio-Canada de 1956 à 1962, qu’on reconnais- sait dès les premières notes de son thème musical : « Ainsi font, font, font… ». Cette émission visait à éduquer les enfants d’âge préscolaire tout en les amusant. Le rôle de Maman Fonfon n’est cepen- dant qu’un aspect de la carrière de cette éduca- trice avant-gardiste qui prônait la scolarisation précoce des enfants par l’entremise de l’implan- tation de la maternelle pour tous. En effet, le fonds d’archives Claudine Vallerand (P897), conservé à BAnQ Vieux-Montréal, permet d’apprendre que cette pionnière de la télévision éducative a fondé et dirigé la première maternelle privée de Mont- réal, la Maternelle Vallerand, au cours des années
Qui se souvient
de Maman Fonfon?
d o s s i e r
1. Claudine Vallerand, « À l’intérieur d’une maternelle », Revue dominicaine, vol. 46, n° 2, février 1940, p. 59-60, cité dans Denyse Baillargeon, « Éduquer les enfants, discipli- ner les parents : les rapports famille-école à Montréal, 1910-1960 », Historical Studies in Education / Revue d’his- toire de l’éducation, automne 2009, p. 52, http://historicalstudie- sineducation.ca/index. php/edu_hse-rhe/ article/view/2110/ (consulté le 15 no- vembre 2013). 2. Fonds Claudine Valle- rand (P897, S2, D1). 3. Denyse Baillargeon, ibid., p. 62.
r Extrait du procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres actifs de l’École des parents, 9 juin 1947. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Claudine Vallerand (P897, S3, D2). Détail. v Enfants de la Maternelle Vallerand, 1938. BAnQ Vieux-Montréal, fonds Claudine Vallerand, (P897, S2, D1). Photographe non identifié.
chologie moderne 3 ». Tel que l’exprime sa devise « S’élever pour élever », l’École vise à guider les parents dans l’éducation de leurs enfants en leur présentant des débats et conférences sur la première enfance, la collaboration parents- maîtres et l’entente conjugale. Elle leur offre éga- lement des cours dispensés par des spécialistes tels des médecins, des psychologues ou encore des sociologues. Le petit fonds d’archives Claudine Vallerand (0,22 mètre linéaire de documents ; 31 photo- graphies ; 1 fi lm) représente une riche source d’information pour le domaine de l’éducation au Québec. Il contient notamment l’ensemble des procès-verbaux de l’École des parents du
Québec (1940-1956), des allocutions et articles de Claudine Vallerand,des photographies de l’émis- sion Maman Fonfon, des lettres d’enfants qui se confient à elle, l’assurent de bien écouter ses conseils et répondent aux questions posées dans son émission. On y trouve également un « Mé- moire sur la radio et télévision scolaires » pré- senté à la commission Parent en 1962 et le ma- nuscrit d’une autobiographie romancée inédite de Claudine Vallerand, intitulée « Au Québec en ce temps-là ».
d o s s i e r
Le premier vise la petite enfance en milieu défavorisé où, faute de pré- vention, des inégalités piégeront les enfants. Le deuxième concerne les adultes, qui devront vivre des transitions pro- fessionnelles exigeant de nouvelles formations et qualifications. Or, il ne sera pas possible de ré- pondre à leurs besoins si nos services de forma- tion demeurent inaccessibles car non offerts à temps partiel, ni les soirs et les fins de semaine. Enfin, le troisième a trait à l’éducation tout au long de la vie. Les services d’éducation des adultes des commissions scolaires et des cégeps ne disposent plus des ressources nécessaires. Je crois que le phénomène de déter- mination sociale des résultats sco- laires est un enjeu majeur auquel a à faire face notre système d’éducation. La migration des jeunes des milieux plus favori- sés vers l’école privée et l’apparition de pro- grammes particuliers sélectifs au secteur public, en réponse à cette migration, font peser une lourde hypothèque sur l’école de quartier.
Une concentration plus élevée d’élèves issus des milieux les moins favorisés et d’élèves à risque d’échec dans les classes ordinaires de ces écoles contribue à créer un déficit éducatif structurel qui se traduit par des écarts de réussite entre jeunes de milieux favorisés et jeunes de milieux défavorisés.
Dans les années 1960, les questions environnementales n’étaient pas en- core à l’avant-scène. Mais on connaît maintenant l’ampleur de la détério- ration des ressources vitales ; on a saisi les liens étroits entre la santé des écosystèmes et celle des populations. Une réflexion profonde s’est enga- gée sur le sens de notre aventure humaine sur Terre, sur notre ancrage au cœur des systèmes de vie. L’éducation contemporaine doit intégrer le rapport à l’environnement comme une di- mension fondamentale du développement per- sonnel et social : le rapport à soi et à l’autre est indissociable du rapport à oïkos, notre maison de vie partagée. Après avoir assuré l’intégration des immigrants à l’école et à la commu- nauté francophones, à un degré ini- maginable pour les auteurs du Rap- port Parent, la société québécoise doit s’adapter à l’ampleur de la transformation identitaire in- hérente à l’atteinte de cet objectif. Dans un contexte de diversification de l’immigration, de tensions internationales sur des bases religieuses et de clivage entre la grande région montréa- laise, multiethnique, et les régions, plus homo- gènes, l’éducation au « vivre ensemble » s’im- pose plus que jamais. Il faut aussi lutter contre la marginalisation que vivent, à l’école comme dans la société, certains élèves issus de groupes « racisés » ou appartenant à des communautés qui font l’objet de controverses publiques.
Dans le sillage des réformes
engendrées par le Rapport
Parent, quels sont les
défis ou les enjeux qui vous
apparaissent pour l’avenir?
d o s s i e r
Premièrement, que le programme de la maternelle à quatre ans à temps plein en milieu défavorisé soit im- planté en intégrant des jeux portant sur des dimensions critiques de la réussite sco- laire, notamment les habiletés sociales, le voca- bulaire, la littératie et la numératie. Deuxième- ment, que l’on ouvre les centres de formation professionnelle et de services de formation conti- nue des cégeps selon des modalités qui tiennent compte des conditions de vie et de travail des adultes qui ont un emploi. Troisièmement, que les services publics d’éducation des adultes réin- tègrent dans leur mission l’éducation populaire, aussi appelée socioculturelle ou communautaire, comme c’est le cas dans plusieurs pays. Pour s’attaquer aux questions d’équi- té et de justice sociale, deux avenues me semblent prometteuses. D’abord, sur le plan des structures et du fonc- tionnement, il faut s’assurer d’une répartition équitable des responsabilités et des charges so- ciales entre les écoles privées et publiques, no- tamment en mettant à profit la notion de respon- sabilité territoriale partagée. Puis, sur le plan éducatif, je mettrais en place des programmes et des approches dont l’efficacité a été démontrée, notamment en ce qui concerne les premiers ap- prentissages en lecture et le développement des habiletés sociales. Des approches efficaces en salle de classe peuvent clairement réduire les écarts de réussite. Pour soutenir cette orientation, je créerais un institut scientifique national d’édu- cation publique qui aurait le mandat de soutenir le développement et le déploiement des meil- leures pratiques éducatives.
Le Rapport Parent manifestait le souhait de former des citoyens in- formés et compétents, capables de s’engager et de participer à l’essor de la démocratie. Accorder une pleine importance à l’éducation relative à l’environnement permet- trait d’y contribuer plus largement, en ouvrant l’idée de citoyenneté à celle d’écocitoyenneté : apprendre à vivre ici ensemble, au cœur de la cité écologique. De l’école à l’université, c’est toute une communauté éducative, toute une so- ciété apprenante qui est ainsi invitée au croise- ment des regards et à la mobilisation des savoirs, dans un vaste chantier collectif visant à réen- chanter le monde.
Est-ce que vous avez
des recommandations
pour l’avenir du
système d’éducation?